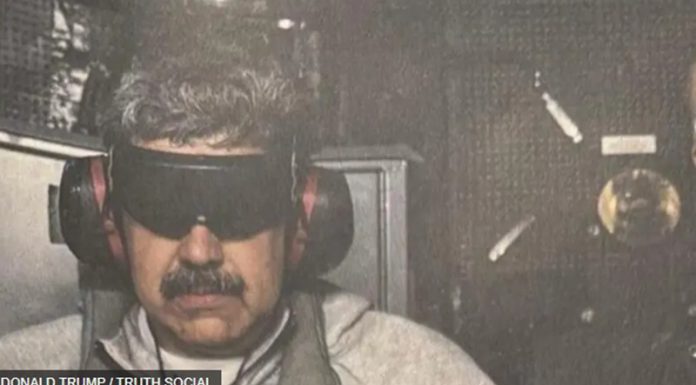[ Publié / Modifié il y a
Le Mali traverse une période critique. Depuis que le JNIM impose un blocus sur le carburant, de vastes zones du pays se retrouvent isolées, sans électricité, sans ravitaillement et souvent sans présence de l’État. Seule Bamako semble encore maintenir un semblant de stabilité, créant un fossé grandissant entre la capitale et les régions.
Dans le sud, notamment autour de Loulouni, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ivoirienne, les attaques se sont intensifiées ces derniers mois. Les populations vivent sous la menace permanente, tandis que les forces régulières brillent par leur absence. Les dozos tentent d’assurer une défense locale, mais ne peuvent rivaliser avec l’organisation du JNIM, qui a ouvertement installé des postes dans la zone. Les images de ses combattants circulant librement dans les rues témoignent d’un contrôle assumé.
Dans plusieurs localités, la situation humanitaire se dégrade rapidement. À Mopti, un imam a lancé un appel désespéré pour demander le retour de l’électricité et du carburant, décrivant une ville laissée à son sort. Même Miss Mali 2024 a dénoncé publiquement l’abandon des régions. À Saye, village coupé du reste du pays depuis près de deux mois, les habitants ne disposent plus de ravitaillement et survivent tant bien que mal.
Le blocus a aussi des répercussions directes pour les pays voisins. Les chauffeurs maliens, ivoiriens et sénégalais qui ravitaillent le pays sont désormais considérés comme des “cibles militaires” par le JNIM. Trois Ivoiriens ont été tués en septembre, et plusieurs Sénégalais ont été enlevés. Quelques convois parviennent encore à avancer sous escorte, mais cela reste insuffisant pour alimenter le pays.
Dans des villes comme Koutiala ou Sikasso, les stations-service sont à sec. À Mopti, le carburant disponible est réservé aux militaires, et les habitants vivent dans le noir depuis de longues semaines. Pendant ce temps, les autorités assurent qu’il ne s’agit que de “perturbations” dans l’approvisionnement, des propos jugés déconnectés de la réalité par les populations.
L’autre sujet de préoccupation concerne le rôle du contingent russe, désormais regroupé sous l’appellation Africa Corps. Présentés comme essentiels pour renforcer les FAMa, les éléments russes sont peu visibles sur les terrains où la pression jihadiste est la plus forte. En revanche, ils sont particulièrement actifs autour de la mine d’Intahaka, qu’ils sécurisent en priorité. Cette focalisation sur le site minier alimente les doutes sur leurs véritables objectifs.
Alors que Bamako tente de préserver son fonctionnement, les régions s’enfoncent dans une crise profonde. L’effondrement des services essentiels, la fermeture progressive des routes et la peur quotidienne fragilisent un pays déjà éprouvé. Pour la Côte d’Ivoire, cette situation représente un risque croissant. Les attaques proches de la frontière et la mise en danger des chauffeurs ivoiriens rappellent que l’instabilité malienne n’est plus un problème lointain, mais une réalité qui peut toucher directement le territoire et les échanges commerciaux.
Le blocus, les violences et l’absence d’une réponse sécuritaire efficace laissent craindre une aggravation de la crise, dans un Mali plus divisé que jamais.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info