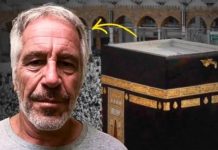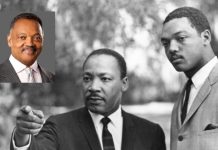[ Publié / Modifié il y a
Depuis Rabat jusqu’à Antananarivo en passant par Katmandou, la jeunesse fait entendre sa voix. Partout où les frustrations sociales s’accumulent et où la corruption semble verrouiller l’avenir, des mouvements de contestation émergent. Au Maroc, le GenZ212 est devenu en quelques semaines un symbole de mobilisation citoyenne. À Madagascar, les étudiants et jeunes urbains s’organisent pour dénoncer la précarité et l’absence de perspectives. Au Népal, c’est la lassitude face au chômage et aux inégalités qui a alimenté la colère d’une génération en quête de reconnaissance.
Ces révoltes de jeunesse, chacune dans son contexte, interrogent : la Côte d’Ivoire pourrait-elle à son tour voir naître un mouvement similaire, notamment à l’approche de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 ?
Des causes universelles, mais des contextes différents
Si l’on observe les mobilisations au Maroc, à Madagascar et au Népal, un constat saute aux yeux : les revendications sont similaires :
• Lutte contre la corruption endémique.
• Demande d’une meilleure gouvernance.
• Réclamations pour l’emploi, l’éducation et la santé.
• Volonté d’avoir enfin une place dans la décision publique.
Au Maroc, les jeunes de GenZ212 ont exprimé leur rejet des investissements jugés inutiles, comme la construction de stades, alors que les hôpitaux manquent de moyens. À Madagascar, la jeunesse a dénoncé la hausse du coût de la vie et la corruption de certains dirigeants. Au Népal, les étudiants sont descendus dans les rues pour réclamer plus d’équité sociale et de réelles perspectives professionnelles.
La Côte d’Ivoire n’est pas étrangère à ces réalités : chômage élevé des jeunes diplômés, vie chère, inégalités persistantes entre les centres urbains et certaines zones rurales, sentiment de confiscation du pouvoir par une élite politico-économique. Mais le contexte ivoirien diffère, notamment en raison de l’histoire récente marquée par les crises électorales violentes de 2000, 2010 et 2020.
Avant et après la présidentielle : deux possibles trajectoires
La jeunesse ivoirienne, qui représente plus de 60 % de la population, pourrait-elle franchir le pas d’une mobilisation comparable au GenZ212 ? Tout dépendra du climat avant et après la présidentielle.
Avant le scrutin : une contestation numérique plus que physique
Il est peu probable qu’un vaste mouvement de rue apparaisse avant le vote. Les jeunes sont conscients des risques de répression, mais aussi des dérives que peuvent prendre les manifestations massives dans un contexte électoral tendu. En revanche, les réseaux sociaux devraient devenir le principal espace de contestation. Dénonciations d’irrégularités, campagnes contre l’achat de voix, diffusion de vidéos ou témoignages : l’activisme numérique pourrait prendre de l’ampleur dans les semaines précédant le scrutin.
Après le scrutin : le vrai test
C’est une fois les résultats annoncés que la situation sera la plus décisive.
Si le processus électoral est perçu comme transparent et crédible, les frustrations pourraient se canaliser vers des mouvements citoyens organisés, cherchant à influencer les politiques publiques sans basculer dans la rue. Mais si le scrutin est jugé biaisé, excluant ou entaché de fraudes massives, la tentation d’une mobilisation de type GenZ212 pourrait être plus forte. Dans ce cas, les réseaux sociaux amplifieraient la contestation, et des rassemblements localisés dans certaines villes pourraient suivre.
La différence fondamentale réside dans la mémoire collective ivoirienne : la peur d’une rechute dans les violences post-électorales reste vive, ce qui peut freiner les ardeurs et rendre la jeunesse plus prudente que ses homologues du Maroc, de Madagascar ou du Népal.
Les réseaux sociaux : accélérateurs et pièges
Qu’il s’agisse de Discord au Maroc, de Facebook à Madagascar ou de TikTok au Népal, les réseaux sociaux jouent un rôle décisif. En Côte d’Ivoire, leur influence est encore plus marquée.
Les avantages sont une mobilisation rapide et à moindre coût, le contournement des canaux traditionnels d’information et la capacité à internationaliser une cause et attirer l’attention des médias étrangers.
Les dangers sont :
• La désinformation : rumeurs, intox et fake news peuvent transformer une colère légitime en chaos incontrôlé.
• La manipulation : certains cyber-activistes exploitent les frustrations pour servir des intérêts politiques ou étrangers.
• Les ingérences : l’espace numérique devient un terrain d’influence pour des puissances extérieures, parfois hostiles, qui cherchent à semer la division et l’instabilité.
L’exemple marocain a montré la puissance d’une mobilisation numérique décentralisée. Mais il met aussi en lumière la fragilité de ce type de contestation, exposée à toutes sortes de récupérations. En Côte d’Ivoire, où les influenceurs politiques occupent déjà une place centrale dans le débat public, un mouvement numérique mal encadré pourrait devenir un terrain fertile pour le cyber activisme malveillant.
La jeunesse ivoirienne entre prudence et impatience
La comparaison avec le Maroc, Madagascar et le Népal permet de dégager une particularité ivoirienne : la jeunesse est à la fois exaspérée et prudente. Elle aspire à plus de justice sociale, mais elle connaît le coût humain de l’instabilité. Cette ambivalence explique pourquoi une contestation à grande échelle est plausible, mais pas certaine.
Tout dépendra de la crédibilité du processus électoral et de la capacité des institutions à donner des gages de transparence. Dans tous les cas, il serait réducteur de considérer la jeunesse ivoirienne uniquement comme une menace d’explosion contestataire : elle peut être aussi une force de proposition et de transformation pacifique si elle est écoutée.
La Côte d’Ivoire se trouve à un moment charnière. L’exemple des mouvements de jeunesse au Maroc, à Madagascar et au Népal montre que les frustrations ignorées finissent toujours par trouver un exutoire. Mais notre pays a déjà connu les dérives de la violence politique, et il ne peut se permettre d’en payer à nouveau le prix.
La jeunesse ivoirienne doit faire entendre sa voix, mais dans le respect de la paix civile. Les réseaux sociaux doivent être utilisés pour construire, informer et mobiliser de manière responsable, et non pour propager la haine ou servir des agendas extérieurs.
À l’approche du 25 octobre, le message à retenir est clair : il faut transformer la colère en énergie constructive, et non en chaos destructeur. L’avenir de la Côte d’Ivoire dépendra de cette maturité collective.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info