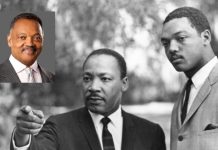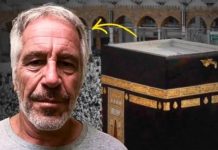[ Publié / Modifié il y a
Le 17 avril 2025, une attaque d’une violence inédite a frappé les forces béninoises au nord du pays, faisant 54 morts parmi les soldats. Deux positions militaires proches des frontières du Burkina Faso et du Niger ont été prises pour cible simultanément par des djihadistes à moto. L’assaut a été revendiqué par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda. Ce bilan constitue le plus lourd jamais enregistré dans cette région.
Ce n’est pas la première fois que le nord du Bénin est frappé : en janvier, 28 soldats y avaient déjà perdu la vie. Mais cette attaque d’avril marque une nette escalade dans la capacité d’action des groupes armés dans la région.
Depuis 2021, les groupes djihadistes utilisent les parcs nationaux transfrontaliers (Pendjari et W), à cheval sur le Bénin, le Burkina et le Niger, comme zones de refuge et de repli. Ces espaces boisés et peu surveillés offrent un terrain idéal pour des incursions régulières. L’absence de surveillance aérienne suffisante et la porosité des frontières facilitent leur infiltration.
L’une des causes majeures de cette progression est l’effondrement de la coopération régionale. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, l’a reconnu publiquement : la situation serait bien différente si la collaboration avec les voisins sahéliens existait encore. Mais cette coopération est désormais rompue.
Le Burkina Faso et le Niger, aujourd’hui gouvernés par des juntes militaires, soupçonnent le Bénin d’héberger des bases étrangères hostiles à leur régime. Cette méfiance a transformé les frontières en murs diplomatiques, coupant court à toute coordination sécuritaire.
Pourtant, les données sont sans appel : le Sahel est aujourd’hui l’épicentre du terrorisme mondial. En 2024, plus de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde ont été enregistrés dans cette région, avec le Burkina Faso en tête du classement mondial.
Selon des experts en sécurité, les groupes comme le JNIM profitent du vide laissé par les États faillis pour s’étendre vers le golfe de Guinée. Ils s’ancrent dans les territoires délaissés, nouent des liens locaux, mènent des actions de propagande, et dissuadent toute collaboration entre les populations et les forces régulières.
Il y a encore peu, des opérations militaires conjointes — comme Taanli ou Sama — permettaient une coordination entre armées sahéliennes et côtières. Mais les putschs successifs et le départ des forces occidentales ont mis fin à ces synergies. L’Alliance des États du Sahel (AES), préférant le repli stratégique, agit désormais seule, laissant les pays côtiers comme le Bénin exposés et isolés.
Cette stratégie d’isolement porte aujourd’hui ses fruits… amers. Tandis que la CEDEAO célèbre ses 50 ans, ses ex-membres du nord, qui ont claqué la porte au nom de la souveraineté, sont devenus des corridors pour l’insécurité régionale.
Le Bénin, en première ligne, tente de résister. Mais sans coopération régionale et face à une menace transnationale, le défi est immense. Pendant ce temps, les groupes djihadistes avancent, méthodiques, dans l’indifférence ou l’impuissance de leurs voisins sahéliens.
F. Kouadio – Cap’Ivoire Info
@CapIvoire_Info / X