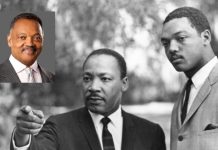[ Publié / Modifié il y a
Le Mali et l’Algérie traversent une grave crise diplomatique depuis l’abattage, début avril 2025, d’un drone malien par l’armée algérienne près de Tin Zaouatène. Cet incident, qui a conduit au rappel des ambassadeurs et à la fermeture des espaces aériens, révèle des tensions plus profondes que le simple différend frontalier. Entre méfiances accumulées, divergences stratégiques et rivalités régionales, c’est toute la stabilité du Sahel qui est mise à l’épreuve.
L’Accord d’Alger : d’un espoir de paix à une source de discorde
L’Algérie avait joué un rôle central dans la médiation de l’Accord de paix signé à Alger en 2015. Mais en janvier 2024, Bamako a dénoncé cet accord, accusant Alger d’ingérence et de soutien implicite à certains groupes armés du Nord. Pour l’Algérie, ce rejet constitue une remise en cause directe de son rôle de puissance stabilisatrice. Depuis, la confiance est rompue entre les deux capitales.
Sécurité au Sahel : deux visions qui s’opposent
Les autorités algériennes privilégient la voie du dialogue politique et de la coopération régionale. À l’inverse, la junte malienne mise sur une stratégie de force, avec l’usage massif de drones et le recours aux mercenaires russes du groupe Wagner. C’est ici que se cristallise le désaccord : Alger rejette fermement toute présence de mercenaires étrangers à ses frontières. Pour Alger, il s’agit d’une menace directe et d’une remise en cause de son autorité dans la région.
Une frontière sensible et des ambitions géopolitiques
Avec une frontière de plus de 1 300 km, l’Algérie redoute que l’instabilité malienne ne se propage sur son territoire. Mais cette fermeté a aussi une dimension politique : Alger entend rappeler qu’elle reste une puissance militaire et diplomatique majeure en Afrique du Nord et en Méditerranée. En se montrant intraitable, elle cherche à protéger sa sécurité mais aussi à défendre son statut de pays incontournable.
L’Afrique de l’Ouest face à ses responsabilités
Cette crise ne concerne pas seulement Bamako et Alger. Elle fragilise l’ensemble de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Dans ce contexte, l’union des pays ouest-africains apparaît indispensable. La Côte d’Ivoire, grâce à ses investissements dans la modernisation de son armée et à son expérience dans la sécurisation du nord, est aujourd’hui l’un des pays les mieux équipés pour faire face aux groupes djihadistes. Elle peut jouer un rôle moteur dans la construction d’une réponse collective et coordonnée à l’échelle régionale.
La crise Mali–Algérie est le symptôme d’un Sahel traversé par des rivalités et des visions opposées de la sécurité. Elle montre aussi à quel point les divisions affaiblissent la lutte contre le terrorisme. Plus que jamais, la stabilité du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest dépendra de la capacité des États à s’unir autour d’objectifs communs.
L’Algérie, qui veut s’affirmer comme puissance de référence, devra composer avec une Afrique de l’Ouest où la Côte d’Ivoire occupe désormais une place centrale. Reste à savoir si Alger acceptera l’émergence de nouveaux pôles d’influence, comme l’Alliance des États du Sahel (AES), ou si elle cherchera à reprendre l’initiative pour s’imposer à nouveau comme médiatrice et acteur incontournable.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info