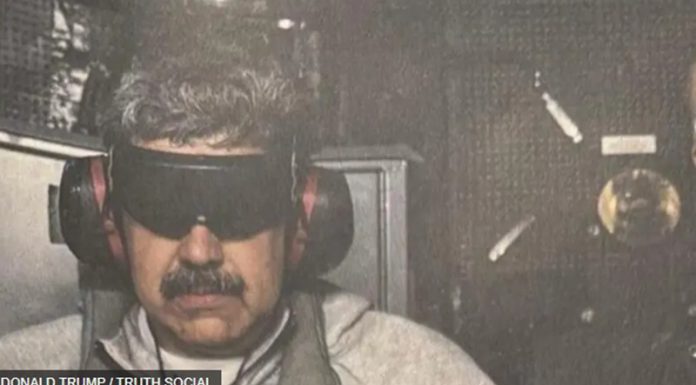[ Publié / Modifié il y a
Au Niger, la décision du régime militaire de faire entrer 369 anciens combattants djihadistes dans l’armée nationale continue de faire polémique. Présentés comme des « repentis », ces hommes, autrefois membres de groupes armés responsables d’attaques meurtrières, ont terminé une courte formation avant d’être intégrés à l’armée. Une initiative que les autorités justifient par la volonté de “réconcilier les Nigériens entre eux”. Mais pour beaucoup, ce geste ressemble à une capitulation morale et sécuritaire.
Une promesse trahie
Lorsque le général Abdourahamane Tiani a pris le pouvoir par un coup d’État en juillet 2023, il avait promis de ramener la sécurité et de rendre au Niger sa souveraineté. Deux ans plus tard, les chiffres racontent une autre histoire. D’après les données du centre ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), plus de 2 400 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes entre juillet 2023 et mars 2025. Malgré les grandes annonces du régime, la situation sur le terrain s’est aggravée.
Face à cet échec, la junte semble avoir choisi une solution de dernier recours : tendre la main à ceux qu’elle n’a pas réussi à vaincre. Selon les autorités, ces ex-combattants auraient “choisi la paix” et renoncé à la violence. Ils ont reçu une brève formation militaire avant d’être intégrés comme soldats. Mais cette stratégie interroge : peut-on transformer en quelques semaines un homme qui a tué, pillé et terrorisé les populations ?
Dans le même temps, les chefs de groupes djihadistes continuent d’appeler à la guerre. L’un d’entre eux a récemment déclaré que « les soldats du Niger sont des infidèles » et que « ceux qui les rejoignent iront en enfer ». Ces propos montrent que la radicalisation reste bien ancrée.
Des contradictions qui dérangent
Le paradoxe est frappant. Depuis plusieurs mois, Niamey accuse son voisin, le Bénin, d’être une “base arrière du terrorisme”. Mais pendant que le régime multiplie les accusations contre l’extérieur, il ouvre ses portes aux anciens ennemis de l’intérieur. Les repentis enrôlés dans l’armée reçoivent un salaire, un uniforme et une légitimité. Ceux qui ne rejoignent pas les rangs bénéficient de “kits d’accompagnement” pour ouvrir un commerce ou démarrer une activité génératrice de revenus.
Cette politique choque dans un pays où la misère et la faim progressent. Le Niger traverse une grave crise économique depuis les sanctions imposées par la CEDEAO, et beaucoup de citoyens peinent à subvenir à leurs besoins. Voir d’anciens terroristes bénéficier d’aides alors que des familles entières n’ont plus de quoi vivre crée un profond sentiment d’injustice.
Un calcul politique risqué
Pour certains analystes, cette décision révèle avant tout l’essoufflement du régime militaire. Après avoir rompu avec les forces françaises et américaines, puis s’être rapproché de la Russie et des alliés de l’AES (Alliance des États du Sahel), le Niger n’a toujours pas trouvé de solution durable au problème du terrorisme.
L’intégration des ex-combattants apparaît donc comme une tentative de calmer le jeu, voire de donner l’impression d’un retour à la paix. Mais cette paix pourrait n’être qu’une illusion. En intégrant d’anciens ennemis dans les forces armées, la junte prend le risque d’une infiltration interne. Certains pourraient conserver des liens avec les groupes extrémistes et compromettre la sécurité de l’État.
Les soldats, eux, ont du mal à accepter cette situation. Comment combattre aux côtés de ceux qui, hier encore, tuaient leurs frères d’armes ? Cette décision risque d’affaiblir davantage la cohésion d’une armée déjà fragilisée.
Le symptôme d’un malaise régional
Ce choix du Niger rappelle les orientations déjà prises par le Mali et le Burkina Faso. Dans ces pays dirigés par des juntes militaires, le discours de souveraineté et d’indépendance cache souvent une crise profonde de gouvernance. Faute de résultats tangibles, ces régimes s’appuient sur des alliances improbables et sur la propagande anti-occidentale pour maintenir leur popularité.
En ouvrant la porte de l’armée aux ex-djihadistes, le général Tiani espère sans doute restaurer un semblant d’ordre. Mais cette stratégie pourrait bien produire l’effet inverse : un affaiblissement durable de l’État et une perte de confiance du peuple envers ses dirigeants.
Au-delà du Niger, cette situation met en lumière une question cruciale pour tout le Sahel : jusqu’où les gouvernements militaires sont-ils prêts à aller pour survivre politiquement, même au prix de leur propre sécurité nationale ?
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info