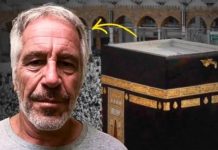[ Publié / Modifié il y a
QUAND LES RELIGIEUX S’ASSEYENT À LA TABLE DU MENSONGE
Ou comment la foi se transforme en instrument de diversion politique dans une République qui trahit ses fondements
Il est des silences qui hurlent. Des silences d’autant plus assourdissants qu’ils émanent de bouches censées incarner la parole divine, le réconfort des âmes blessées, l’écho moral des sociétés vacillantes. Des silences complices, pesants, mortifères. En Côte d’Ivoire, alors que les fondements mêmes de la démocratie sont méthodiquement sapés, alors que des milliers de citoyens sont exclus des listes électorales sans motif valable, pendant que d’autres — fictifs ou étrangers à la souveraineté nationale — y sont frauduleusement ajoutés, ces silences religieux deviennent une partie du problème.
Pire : ils sont parfois mobilisés, sollicités, flattés, pour jouer un rôle plus actif encore dans cette vaste entreprise de mise en scène du mensonge et de la fraude éhontée. Le pouvoir les appelle, les installe à sa table, leur offre la parole pour mieux éteindre celle des citoyens spoliés. Il leur tend des micros pour qu’ils prêchent l’apaisement, alors que la colère gronde, qu’elle est légitime, qu’elle est politique. Il leur demande de bénir ce qui devrait être dénoncé, d’implorer le pardon au lieu d’exiger la vérité.
Dans une République qui se dit laïque, cela devrait provoquer l’indignation. Mais la confusion est savamment entretenue. On enrobe la manipulation d’un vernis spirituel. On appelle cela «intercession», « prière pour la paix », « dialogue avec et interreligieux», comme si la foi devait forcément se substituer à la loi. Comme si la morale religieuse pouvait corriger les injustices électorales, ou les couvrir. Mais à y regarder de plus près, ce qu’on attend de ces hommes de foi, ce n’est ni la vérité, ni la justice. Ce qu’on attend, c’est leur silence. Leur bénédiction du statu quo. Leur fonction de paravent.
EN COTE D’IVOIRE, ON PRIE BEAUCOUP. MAIS ON TRICHE ENCORE PLUS.
Les églises et les mosquées poussent en Côte d’Ivoire comme des champignons après la pluie, envahissant les rues, les marchés, les carrefours et les ondes radios. La ferveur religieuse est spectaculaire, omniprésente, multiforme. Mais pendant ce temps, la démocratie se meurt lentement, asphyxiée dans les couloirs obscurs de la Commission Électorale dite Indépendante mais qui en réalité est une Commission Électorale Inféodée, gangrenée par l’arbitraire, affaiblie par la fraude, trahie par ceux qui devraient en être les gardiens.
Ce n’est pas la foi qui est en cause ici. C’est son instrumentalisation. Ce n’est pas Dieu que l’on juge, ce sont ceux qui prétendent parler en son nom tout en servant d’autres maîtres — bien plus terrestres, bien plus cyniques. Le véritable blasphème, ce n’est pas de s’opposer à l’injustice. C’est de la couvrir au nom de la paix. C’est de remplacer la vérité prophétique par la prudence diplomatique. C’est de troquer l’autel contre la table du pouvoir, la chaire contre le pupitre officiel, la parole divine contre les éléments de langage du régime.
À ceux qu’on exclut de la liste électorale, on demande des prières.
À ceux qu’on prive du droit de vote, on offre des versets.
À ceux qu’on humilie dans leur citoyenneté, on sert des sourates, des psaumes, des incantations.
Mais jamais une prise de position claire. Jamais un mot ferme pour dénoncer le scandale d’État. Jamais une citation de la Constitution. Jamais une revendication des droits. Juste l’appel lancinant à la paix. Toujours la paix. Même lorsque l’injustice est flagrante. Même lorsque la fraude est systémique. Même lorsque la colère du peuple est étouffée à coups de discours pieux et de mains jointes devant les caméras.
Depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui a consacré le principe de « la victoire par les armes » et mis au placard celui de « la victoire par les urnes », la foi a souvent été utilisée comme calmant. On a béni les armes des vainqueurs. On a absous les abus. On a encouragé la réconciliation sans vérité. Et aujourd’hui encore, à l’approche d’un nouveau scrutin, les mêmes recettes sont ressorties : prières œcuméniques, messes pour la paix, invocations pour le pardon. Mais pour ceux qui subissent l’exclusion, ces rituels sont vécus comme une insulte. Car ce que réclame le peuple, ce n’est pas une paix abstraite : c’est la justice.
LA RÉPUBLIQUE EST LAÏQUE. CELA NE SIGNIFIE PAS QU’ELLE REJETTE LA FOI. CELA SIGNIFIE SIMPLEMENT QU’ELLE LA TIENT A DISTANCE DU POUVOIR.
La foi peut nourrir les consciences, éclairer les choix, apaiser les tensions. Mais elle ne peut — elle ne doit — en aucun cas devenir un outil de diversion, un rideau de fumée, une caution morale pour des actes illégitimes. Or, c’est bien ce qui se joue aujourd’hui : une confusion dangereuse entre la spiritualité et la stratégie politique. Une instrumentalisation douce mais perverse, dans laquelle certains religieux se laissent glisser, parfois sans même en mesurer les conséquences.
Et pourtant, ce n’est pas la foi qui manque. Ce n’est pas la spiritualité qui fait défaut. C’est le courage. Le courage de dire non. Le courage d’appeler le mensonge par son nom. Le courage de refuser les invitations hypocrites à prêcher la paix, quand la justice est piétinée. Le courage, enfin, de rappeler que le droit de vote n’est pas une faveur divine, mais un droit constitutionnel. Inaliénable. Imprescriptible. Non négociable.
IL NE S’AGIT PAS ICI DE SAUVER DES AMES, MAIS DE SAUVER LA SOUVERAINETE DU PEUPLE.
Les religieux qui acceptent de jouer le jeu du pouvoir ne rendent service ni à Dieu, ni aux hommes. Ils se font les aumôniers d’un système d’exclusion. Les chaplains d’un mensonge organisé. Leurs sermons deviennent des anesthésiants. Leur silence, un consentement. Leur parole, un outil de domination symbolique.
Il est temps de mettre fin aux faux-semblants.
Que chacun retourne à sa place :
— les prêtres à leurs autels,
— les imams à leurs minbars,
— les pasteurs à leurs chaires.
À moins, bien sûr, qu’ils n’aient le courage de briser le silence, de dénoncer clairement la mascarade électorale, et d’assumer une parole véritablement prophétique.
Car on ne soigne pas une démocratie malade avec de l’eau bénite, des prières publiques et des slogans interreligieux.
On la soigne par la loi, la transparence, la participation égale de tous.
On ne répare pas l’injustice en psalmodiant.
On la combat.
On ne recouvre pas l’exclusion électorale sous le tapis du « vivre-ensemble ».
On la dénonce.
Et si les religieux veulent véritablement se mettre du côté de la vérité, qu’ils commencent par rappeler une chose simple :
La République n’est pas un temple.
La Constitution n’est pas un livre sacré au sens divin du terme.
Mais c’est à elle, et à elle seule, que nous devons obéir dans l’arène politique.
LE TRAVESTISSEMENT DE LA FOI : UNE PENTE GLISSANTE ET ANCIENNE
Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que les figures religieuses se retrouvent enrôlées au service du pouvoir. D’innombrables régimes, à travers les siècles, ont su manipuler les symboles de la foi pour justifier leurs abus, endormir les peuples et faire passer la soumission pour une vertu. Le phénomène n’est pas nouveau : du Moyen Âge à nos jours, les autocraties ont toujours trouvé des soutiens dans les temples.
Mais la Côte d’Ivoire n’est pas un royaume féodal. C’est une République. Une République issue de luttes, d’espoirs, de sacrifices. Une République qui, malgré ses balbutiements, ses déchirures et ses trahisons, porte en elle une promesse : celle de l’égalité politique, du droit de vote, de la souveraineté populaire.
Lorsque des religieux trahissent cette promesse en prêtant leur voix — ou leur silence — à ceux qui confisquent les droits du peuple, ils participent à une entreprise de démolition républicaine. Et cela doit être dit sans détour : il ne peut y avoir de neutralité religieuse face à l’injustice politique. Le silence, ici, est un parti pris. L’appel à la paix, quand il s’adresse uniquement à ceux qui souffrent sans s’adresser aux responsables de l’injustice, devient une forme d’oppression.
Et cette oppression est d’autant plus redoutable qu’elle porte un masque. Le masque du sacré. Le masque du « vivre-ensemble » qui se déroule dans un contexte de rattrapage ethnique. Le masque de la réconciliation. Mais une réconciliation sans vérité et tribalisée est une tromperie. Un vivre-ensemble sans justice est une mise en scène. Une paix fondée sur l’exclusion est une guerre larvée.
LA RESPONSABILITE MORALE DES RELIGIEUX : BENIR OU DENONCER ?
Il est temps que les autorités religieuses s’interrogent profondément. Leur rôle est-il de pacifier la colère ou d’en comprendre les raisons ? Leur mission est-elle de consoler les victimes ou d’éclairer les causes du mal ? Leur devoir consiste-t-il à invoquer la paix — ou à dénoncer l’oppression qui l’empêche ?
Une foi véritable ne pactise pas avec le mensonge. Elle l’éclaire, le confronte, le nomme. Elle n’élude pas les responsabilités, elle les expose. Elle ne cherche pas à étouffer les cris, mais à leur donner sens. Elle ne détourne pas les regards, elle les oriente vers la vérité.
Aujourd’hui, une partie du clergé ivoirien — chrétien, musulman ou autre — est face à un choix historique. Celui de la parole ou du silence. Celui de la complicité ou de l’intégrité. Celui du confort institutionnel ou du courage prophétique.
Car l’histoire jugera. L’histoire se souviendra. Elle retiendra ceux qui, dans les heures sombres, ont osé parler — même seuls, même incompris. Elle retiendra aussi ceux qui ont choisi de se taire, de collaborer, de détourner le regard, de bénir le pouvoir quand il fallait le combattre.
La démocratie ivoirienne ne peut pas être sauvée par les prières. Elle exige des actes.
Elle exige que l’on garantisse l’accès à la liste électorale à tous les citoyens.
Elle exige que l’on condamne publiquement la fraude et l’exclusion.
Elle exige que l’on rappelle que la souveraineté populaire ne se partage pas, ne se troque pas, ne se falsifie pas.
Elle exige que les hommes de Dieu restent du côté de la vérité, pas du pouvoir.
LE TEMPS DE LA CLARTE EST VENU
On ne soigne pas une blessure politique avec de l’eau bénite.
On ne redonne pas voix à un peuple avec des prières du vendredi.
On ne restaure pas l’équité électorale avec des psaumes.
On ne calme pas une nation trahie avec des appels au pardon.
La paix ne se décrète pas. Elle se construit sur la justice. Elle se fonde sur l’égalité des droits. Elle se consolide dans la confiance entre les institutions et les citoyens. Or cette confiance est aujourd’hui rompue. Fragilisée. Défigurée.
Face à cela, il est de la responsabilité de chacun — religieux, intellectuels, artistes, citoyens ordinaires — de refuser la résignation. De refuser l’anesthésie spirituelle. De nommer l’exclusion. De dénoncer la manipulation. De rappeler que dans une démocratie digne de ce nom, nul ne peut être privé de son droit de vote sans que cela soit vécu comme un viol du contrat républicain.
Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas ici d’un débat théologique. Il s’agit de souveraineté. Il s’agit de droit. Il s’agit de liberté. Et si les religieux veulent s’engager dans le débat public, qu’ils le fassent à visage découvert, avec courage, avec cohérence. Mais qu’ils sachent qu’en choisissant de s’asseoir à la table du mensonge, ils quittent celle de la vérité.
©DR KOCK OBHUSU, Économiste